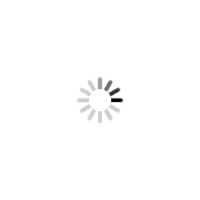






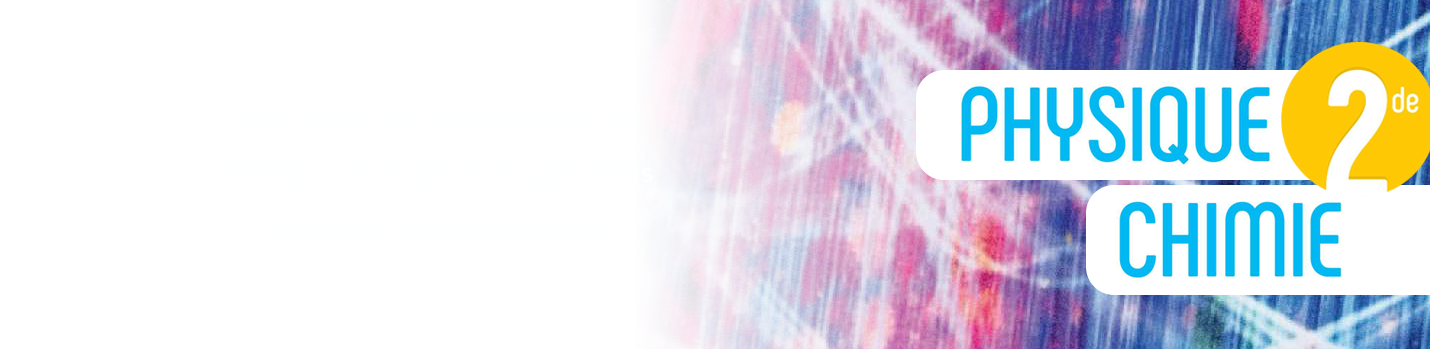
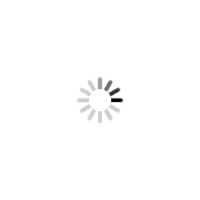




|
Matière Qu’est-ce qu’un corps pur ? un mélange ? Fiche 1 |
Un corps pur est constitué d’une seule espèce chimique. Un mélange est constitué de plusieurs espèces chimiques. |
|
Matière Que dire de deux liquides formant un mélange homogène ? Fiche 2 |
Deux liquides formant un mélange homogène sont dits miscibles. |
|
Matière Que dire du mélange formé par l’air ? Donner sa composition volumique approximative. Fiche 3 |
L’air est un mélange homogène de plusieurs gaz formé d’environ 80 % de diazote et 20 % de dioxygène. |
|
Matière Définir la masse volumique d’une espèce chimique. Fiche 4 |
La masse volumique d’une espèce chimique correspond à la masse d’un échantillon de cette espèce par unité de volume. Elle s’obtient en divisant la masse de cet échantillon par le volume de cet échantillon. |
|
Matière Donner les masses volumiques de l’eau et de l’air. Fiche 5 |
ρeau = 1 000 g·L−1 ou 1,0 g·mL−1 ρair = 1,3 g·L−1 |
|
Matière Nommer l’appareil permettant de mesurer une température de fusion. Fiche 6 |
Un banc Kofler. |
|
Matière Décrire le test chimique permettant de mettre en évidence la présence d’eau. Fiche 7 |
Le sulfate de cuivre anhydre blanc devient bleu en présence d’eau. |
|
Matière Décrire le test chimique permettant de mettre en évidence la présence de dioxygène. Fiche 8 |
Une bûchette incandescente se rallume en présence de dioxygène. |
|
Matière Décrire le test chimique permettant de mettre en évidence la présence de dihydrogène. Fiche 9 |
Une flamme approchée d’un flacon contenant du dihydrogène provoque une détonation. |
|
Matière Décrire le test chimique permettant de mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone. Fiche 10 |
Un précipité blanc se forme dans l’eau de chaux en présence de dioxyde de carbone. |
|
Matière Quelle est l’utilité d’une chromatographie sur couche mince ? Fiche 11 |
Une chromatographie sur couche mince (CCM) permet d’identifier les espèces chimiques d’un mélange homogène. |
|
Matière Quelle information fournit une lecture verticale d’un chromatogramme ? Fiche 12 |
Si le chromatogramme fait apparaître plusieurs taches verticalement, le dépôt est un mélange. |
|
Matière Quelle information fournit une lecture horizontale d’un chromatogramme ? Fiche 13 |
Si le chromatogramme fait apparaître deux taches alignées horizontalement, celles-ci correspondent à la même espèce chimique. |
|
Matière Qu’est-ce qu’une solution ? Fiche 1 |
C’est un mélange homogène d’un ou plusieurs solutés et d’un solvant. |
|
Matière Qu’est-ce qu’un soluté ? Fiche 2 |
C’est l’espèce chimique dissoute dans le solvant. |
|
Matière Nommer le solvant d’une solution aqueuse. Fiche 3 |
Le solvant d’une solution aqueuse est l’eau. |
|
Matière Définir la concentration en masse d’un soluté en solution. Fiche 4 |
C’est la masse de soluté dissous par litre de solution. |
|
Matière Donner l’expression mathématique permettant de calculer la concentration en masse \( C_{m} \) et préciser les unités. Fiche 5 |
\[ C_{m} = \frac{m}{V} \] avec \( C_{m} \) la concentration en masse en g·L–1 \( m \) la masse de soluté en g \( V \) le volume de solution en L |
|
Matière Quelle est la différence entre la masse volumique d’une solution et la concentration en masse d’un soluté en solution ? Fiche 6 |
La masse volumique d’une solution est le rapport de la masse de la solution par son volume. La concentration en masse d’un soluté en solution est le rapport de la masse de soluté par le volume de solution. |
|
Matière Que dire d’une solution dont la concentration en masse de soluté est maximale ? Fiche 7 |
La solution est saturée. |
|
Matière Citer deux techniques permettant de préparer une solution. Fiche 8 |
On peut préparer une solution par dissolution ou par dilution. |
|
Matière Qu’est-ce qu’une dissolution ? Fiche 9 |
C’est la mise en solution d’une espèce chimique. |
|
Matière Que signifie diluer une solution ? Fiche 10 |
C’est ajouter du solvant à un volume de solution mère pour préparer une solution fille. |
|
Matière Quelle grandeur se conserve lors d’une dilution ? Fiche 11 |
La masse de soluté se conserve lors d’une dilution. |
|
Matière Quelle verrerie utilise-t-on lors d’une dilution ? Fiche 12 |
Une pipette jaugée et une fiole jaugée. |
|
Matière Que représente le numéro atomique Z pour un noyau ? Fiche 1 |
Z correspond au nombre de protons dans le noyau. |
|
Matière Que représente le nombre de masse A pour un noyau ? Fiche 2 |
A correspond au nombre de nucléons dans le noyau. |
|
Matière Donner l’écriture conventionnelle du noyau d’un atome. Fiche 3 |
\( _{Z}^{A}\textrm{X} \) : A est en exposant à gauche du symbole X, Z est en indice. |
|
Matière Comment détermine-t-on le nombre de neutrons N dans un noyau ? Fiche 4 |
N = A – Z |
|
Matière Que peut-on dire du nombre d’électrons dans un atome ? Fiche 5 |
Dans un atome, le nombre d’électrons est égal au nombre de protons. |
|
Matière Donner l’ordre de grandeur de la taille d’un atome. Fiche 6 |
10-10 m |
|
Matière Donner l’ordre de grandeur de la taille du noyau d’un atome. Fiche 7 |
10-15 m |
|
Matière À quoi correspond chaque période (ou chaque ligne) du tableau périodique ? Fiche 8 |
Cela correspond aux éléments chimiques ayant le même nombre de couches électroniques. |
|
Matière Comment appelle-t-on les électrons de la dernière couche électronique occupée d’un atome ? Fiche 9 |
Les électrons de valence. |
|
Matière Quel lien y a-t-il entre le nombre d’électrons de valence et le tableau périodique ? Fiche 10 |
Le nombre d’électrons de valence correspond à l’unité de la colonne dans le tableau périodique. |
|
Matière Comment repère-t-on, dans le tableau périodique, les éléments appartenant à une même famille chimique ? Fiche 11 |
Les éléments d’une même famille chimique sont dans une même colonne du tableau périodique. |
|
Matière Dans le tableau périodique, où se situe la famille des gaz nobles ? Fiche 12 |
Dans la 18e colonne. |
|
Matière Indiquer la particularité de la configuration électronique des atomes de gaz noble. Fiche 1 |
Leur couche de valence est saturée. |
|
Matière Donner la formule des ions hydrogène, potassium, calcium, magnésium, chlorure. Fiche 2 |
H+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl– |
|
Matière Comment se forme une liaison entre deux atomes ? Fiche 3 |
Il y a mise en commun de deux électrons de valence, chaque atome en apportant un. |
|
Matière Qu’est-ce qu’un doublet non liant ? Fiche 4 |
Ce sont deux électrons de valence d’un atome qui ne participent pas à une liaison. |
|
Matière Comment représente-t-on un doublet non liant dans le schéma de Lewis ? Fiche 5 |
Par un trait autour du symbole de l’atome. |
|
Matière Pourquoi certains atomes forment-ils des ions ? Fiche 6 |
Pour être stable comme le gaz noble le plus proche. |
|
Matière Combien d’électrons entourent les atomes d’hydrogène, de carbone et d’oxygène dans une molécule stable ? Fiche 7 |
Deux électrons entourent un atome d’hydrogène, huit électrons entourent les atomes de carbone et d’oxygène. |
|
Matière Qu’est-ce que l’énergie de liaison ? Fiche 8 |
C’est l’énergie qu’il faut apporter pour rompre une liaison. |
|
Matière Comment calcule-t-on la masse d’une molécule ? Fiche 1 |
On ajoute les masses des atomes qui constituent la molécule. |
|
Matière Définir une mole d’entités. Fiche 2 |
Une mole d’entités chimiques contient 6,02 × 1023 entités chimiques identiques. |
|
Matière Comment calcule-t-on le nombre \( N \) d’entités dans un échantillon, connaissant la masse \( m \) de l’échantillon et la masse \( m_{\mathrm{entite}} \) d’une entité ? Fiche 3 |
\[ N = \frac{m}{m_{\mathrm{entite}}} \] |
|
Matière Donner la relation liant la quantité de matière \( n \) et le nombre d’entités \( N \) d’un échantillon. Fiche 4 |
\[ n = \frac{N}{6,02 \times 10^{23} } \] |
|
Matière Donner l’unité de la quantité de matière. Fiche 5 |
L’unité de la quantité de matière est la mole, de symbole mol. |
|
Matière Qu’est-ce qu’un changement d’état ? Fiche 1 |
Une transformation physique correspondant au passage d’un état physique à un autre. |
|
Matière Définir un changement d’état endothermique. Fiche 2 |
Changement d’état au cours duquel le système absorbe de l’énergie. |
|
Matière Définir un changement d’état exothermique. Fiche 3 |
Changement d’état au cours duquel le système libère de l’énergie. |
|
Matière Citer trois changements d’état endothermiques. Fiche 4 |
Fusion, vaporisation, sublimation. |
|
Matière Citer trois changements d’état exothermiques. Fiche 5 |
Solidification, liquéfaction, condensation. |
|
Matière Définir l’énergie massique de changement d’état. Fiche 6 |
Énergie thermique, libérée ou absorbée par transfert thermique, par 1 kg de corps pur, nécessaire à son changement d’état à température et pression constantes. |
|
Matière Donner le signe de l’énergie massique L d’un changement d’état exothermique. Fiche 7 |
L < 0 |
|
Matière Définir une fusion. Fiche 8 |
Changement d’état de solide à liquide. |
|
Matière Qu’est-ce qu’un réactif ? Fiche 1 |
Une espèce chimique consommée lors d’une transformation chimique. |
|
Matière Qu’est-ce qu’un produit ? Fiche 2 |
Une espèce chimique formée lors d’une transformation chimique. |
|
Matière Qu’est-ce qu’une espèce chimique spectatrice ? Fiche 3 |
Une espèce chimique spectatrice ne participe pas à la transformation chimique. |
|
Matière Dans une équation de réaction, où sont écrits les réactifs par rapport à la flèche ? Fiche 4 |
À gauche. |
|
Matière Dans une équation de réaction, où sont écrits les produits par rapport à la flèche ? Fiche 5 |
À droite. |
|
Matière Quelles lois faut-il respecter pour équilibrer une équation de réaction ? Fiche 6 |
- Loi de conservation des éléments chimiques. - Loi de la charge électrique globale. |
|
Matière Qu’est-ce qu’un réactif limitant ? Fiche 7 |
Le réactif limitant est le réactif totalement consommé en premier lors d’une transformation chimique. |
|
Matière Comment identifier un réactif limitant ? Fiche 8 |
C’est celui pour lequel le rapport de sa quantité de matière initiale sur son nombre stœchiométrique est le plus petit. |
|
Matière Qu’est-ce qu’une transformation chimique endothermique ? Fiche 9 |
Une transformation au cours de laquelle le système chimique absorbe de l’énergie. |
|
Matière Qu’est-ce qu’une transformation chimique exothermique ? Fiche 10 |
Une transformation au cours de laquelle le système chimique libère de l’énergie. |
|
Matière Quel est l’intérêt d’une synthèse chimique ? Fiche 1 |
Une synthèse chimique permet de fabriquer une espèce chimique à l’aide d’une ou plusieurs transformations. |
|
Matière Nommer un montage qui peut être utilisé pour synthétiser une espèce chimique. Fiche 2 |
Chauffage à reflux. |
|
Matière Citer deux intérêts du montage de chauffage à reflux. Fiche 3 |
Accélérer la transformation chimique et éviter les pertes de matière. |
|
Matière Indiquer le rôle du réfrigérant dans le montage à reflux. Fiche 4 |
Le réfrigérant permet de liquéfier les vapeurs. |
|
Matière Qu’est-ce qu’un reflux ? Fiche 5 |
C’est le retour des espèces dans le mélange après liquéfaction des vapeurs. |
|
Matière À quel niveau du réfrigérant l’arrivée d’eau se fait-elle ? Fiche 6 |
Par le bas. |
|
Matière Citer un élément du montage de chauffage à reflux qui permet de manipuler en sécurité. Fiche 7 |
Le support élévateur. |
|
Matière Comment peut-on identifier l’espèce chimique synthétisée ? Fiche 8 |
En réalisant une chromatographie sur couche mince ou en déterminant une des caractéristiques physiques (masse volumique, température de changement d’état, etc.) de l’espèce chimique. |
|
Matière Définir des isotopes. Fiche 1 |
Noyaux ayant le même numéro atomique Z mais un nombre de nucléons A différent. |
|
Matière Définir une transformation nucléaire. Fiche 2 |
Transformation au cours de laquelle des nucléons de noyaux ou des particules libres se réarrangent. |
|
Matière Définir une fission. Fiche 3 |
Transformation nucléaire au cours de laquelle un noyau lourd est fragmenté en noyaux plus légers. |
|
Matière Définir une fusion. Fiche 4 |
Transformation nucléaire au cours de laquelle des noyaux légers s’assemblent pour former un noyau plus lourd. |
|
Matière Citer les lois de conservation lors d’une transformation nucléaire. Fiche 5 |
- Conservation du nombre de nucléons. - Conservation de la charge électrique. |
|
Matière Qualifier la fission et la fusion d’un point de vue énergétique. Fiche 6 |
Ce sont des transformations exothermiques. |
|
Matière Nommer le type de transformation nucléaire se produisant dans une centrale électrique. Fiche 7 |
La fission. |
|
Matière Nommer le type de transformation nucléaire se produisant dans le Soleil. Fiche 8 |
La fusion. |
|
Mouvement et interactions Que faut-il définir pour décrire un mouvement ? Fiche 1 |
Le système étudié et le référentiel. |
|
Mouvement et interactions Définir un référentiel. Fiche 2 |
C’est l’objet de référence supposé fixe par rapport auquel on étudie le mouvement. On lui associe un repère d’espace et de temps. |
|
Mouvement et interactions Qualifier un mouvement dont la trajectoire est une droite. Fiche 3 |
Mouvement rectiligne. |
|
Mouvement et interactions Qualifier un mouvement pour lequel la valeur de la vitesse est constante. Fiche 4 |
Mouvement uniforme. |
|
Mouvement et interactions Comment calcule-t-on la valeur de la vitesse d’un point \( \mathrm{M} \) ? Fiche 5 |
\[ v = \frac {\mathrm{MM’}} {\Delta t} \] avec \( \mathrm{MM’} \) la distance entre deux positions successives \( \Delta t \) la durée entre ces deux positions |
|
Mouvement et interactions Donner les caractéristiques du vecteur vitesse. Fiche 6 |
• Direction (celle de \( \mathrm{MM’} \)). • Sens (celui du mouvement). • Norme (proportionnelle à la valeur de la vitesse compte tenu de l’échelle). |
|
Mouvement et interactions Que dire du vecteur vitesse d’un mouvement rectiligne uniforme ? Fiche 7 |
Le vecteur vitesse est constant. |
|
Mouvement et interactions Que dire du vecteur vitesse d’un mouvement rectiligne accéléré ou décéléré ? Fiche 8 |
Le vecteur vitesse garde la même direction et le même sens mais sa norme varie : il n’est pas constant. |
|
Mouvement et interactions Comment modélise-t-on une action exercée par un système sur un autre ? Fiche 1 |
Par une force. |
|
Mouvement et interactions Comment représente-t-on une force ? Fiche 2 |
Par un vecteur. |
|
Mouvement et interactions Comment caractérise-t-on une force ? Fiche 3 |
Par sa direction, son sens et sa valeur. |
|
Mouvement et interactions Donner les caractéristiques du poids. Fiche 4 |
- Direction : verticale. - Sens : vers le bas. - Valeur : \( P = m \times g \) avec \( m \) la masse de l’objet et \( g \) l’intensité de pesanteur sur Terre. |
|
Mouvement et interactions À quelle force assimile-t-on le poids d’un objet sur Terre ? Fiche 5 |
À la force d’interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur l’objet. |
|
Mouvement et interactions Donner les caractéristiques de la force d’interaction gravitationnelle exercée par un système \( \mathrm{A} \) sur un système \( \mathrm{B} \). Fiche 6 |
- Direction : droite qui joint les centres des systèmes. - Sens : vers le centre du système attracteur \( \mathrm{A} \). - Valeur : \( F = \mathrm{G} \times \frac {m_{\mathrm{A}} \ \times \ m_{\mathrm{B}} }{ d^{2} } \) avec \( m_{\mathrm{A}} \) et \( m_{\mathrm{B}} \) les masses respectives des systèmes \( \mathrm{A} \) et \( \mathrm{B} \) \( d \) la distance entre leurs centres \( \mathrm{G} \) la constante de gravitation universelle |
|
Mouvement et interactions Énoncer le principe des actions réciproques. Fiche 7 |
Si un système A exerce une force sur un système B alors B exerce réciproquement et simultanément une force sur A. Ces forces ont même direction, même valeur mais des sens contraires. |
|
Mouvement et interactions Que peut-on affirmer lorsqu’un système est en mouvement rectiligne uniforme ou immobile ? Fiche 1 |
Que les forces qui s’exercent sur ce système se compensent. |
|
Mouvement et interactions Que dire du mouvement d’un système si la somme vectorielle des forces qui s’exercent sur ce système est nulle ? Fiche 2 |
Le système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. |
|
Mouvement et interactions Dans quel cas la somme vectorielle de deux forces est-elle nulle ? Fiche 3 |
Lorsque les deux forces sont représentées par des vecteurs de même direction, de même norme mais de sens opposés (les deux forces se compensent). |
|
Mouvement et interactions Que dire de la somme vectorielle des forces d’un système en mouvement de chute libre ? Fiche 4 |
La somme vectorielle n’est pas nulle. |
|
Ondes et signaux Qu’est-ce qu’un signal sonore périodique ? Fiche 1 |
C’est un signal présentant un motif élémentaire qui se reproduit à l’identique à des intervalles de temps égaux. |
|
Ondes et signaux Définir la période d’un signal sonore périodique. Fiche 2 |
Durée d’un motif élémentaire. |
|
Ondes et signaux Définir la fréquence d’un signal sonore périodique. Fiche 3 |
Nombre de motifs élémentaires par seconde. |
|
Ondes et signaux Donner la relation entre la période et la fréquence et préciser les unités. Fiche 4 |
La période en seconde est l’inverse de la fréquence en hertz. |
|
Ondes et signaux Quel est le domaine de fréquences des sons audibles ? Fiche 5 |
Entre 20 Hz et 20 kHz. |
|
Ondes et signaux À quelle condition un signal sonore est-il émis ? Fiche 6 |
Il faut qu’un objet vibre pour émettre un signal sonore. |
|
Ondes et signaux Comment s’explique la propagation d’un signal sonore ? Fiche 7 |
Par un déplacement, de proche en proche, de zones de compression et de dilatation de la matière créées par les vibrations d’un émetteur dans un milieu matériel. |
|
Ondes et signaux Pourquoi le son ne peut-il pas se propager dans le vide ? Fiche 8 |
Le son a besoin d’un milieu matériel pour se propager. |
|
Ondes et signaux Donner la valeur de la vitesse de propagation du son dans l’air à 20 °C. Fiche 9 |
340 m·s–1 |
|
Ondes et signaux Qu’est-ce qui différencie un son grave d’un son aigu ? Fiche 10 |
La hauteur du son, qui est liée à sa fréquence. Un son aigu a une fréquence plus élevée qu’un son grave. |
|
Ondes et signaux Quelle caractéristique du son différencie une même note jouée par deux instruments différents ? Fiche 11 |
Le timbre du son, lié à la forme du signal. |
|
Ondes et signaux Quelle caractéristique des sons permet de les classer en fonction de leur dangerosité ? Donner son unité. Fiche 12 |
Le niveau d’intensité sonore, en décibel (dB). |
|
Ondes et signaux Comment la lumière se propage-t-elle dans un milieu transparent homogène ? Fiche 1 |
En ligne droite. |
|
Ondes et signaux Donner la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l’air. Fiche 2 |
300 000 km·s−1 |
|
Ondes et signaux Nommer les deux phénomènes se produisant à la surface de séparation entre deux milieux transparents homogènes. Fiche 3 |
La réflexion et la réfraction. |
|
Ondes et signaux Donner la loi de Snell-Descartes pour la réflexion. Fiche 4 |
i = i’ avec i l’angle d’incidence i’ l’angle de réflexion |
|
Ondes et signaux À quelle condition observe-t-on la réfraction de la lumière ? Fiche 5 |
Lorsque la lumière passe d’un milieu de propagation transparent à un autre milieu transparent de propagation, avec un angle d’incidence non nul. |
|
Ondes et signaux Qu’est-ce que l’angle de réfraction ? Fiche 6 |
C’est l’angle entre le rayon réfracté et la normale à la surface de séparation entre les deux milieux. |
|
Ondes et signaux Donner la loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Fiche 7 |
n1 × sin i = n2 × sin r avec n1 l’indice de réfraction du milieu où se propage le rayon incident n2 celui du milieu où se propage le rayon réfléchi i l’angle d’incidence r l’angle de réfraction |
|
Ondes et signaux De quoi la lumière blanche est-elle constituée ? Fiche 1 |
D’une infinité de lumières colorées. |
|
Ondes et signaux Qu’est-ce qu’un spectre lumineux ? Fiche 2 |
La figure obtenue par dispersion de la lumière. |
|
Ondes et signaux Décrire le spectre du rayonnement émis par un corps chaud. Fiche 3 |
Spectre continu constitué de lumières colorées. |
|
Ondes et signaux Décrire un spectre de raies d’émission d’un élément chimique. Fiche 4 |
Spectre discontinu composé de raies colorées sur un fond noir. |
|
Ondes et signaux Comment caractérise-t-on un rayonnement monochromatique ? Fiche 5 |
Par sa longueur d’onde. |
|
Ondes et signaux Qu’est-ce qu’un milieu dispersif ? Fiche 6 |
C’est un milieu dont l’indice de réfraction dépend de la longueur d’onde du rayonnement qui le traverse. |
|
Ondes et signaux Citer un exemple de milieu dispersif. Fiche 7 |
Le prisme en verre. |
|
Ondes et signaux Donner les limites du domaine du visible. Fiche 8 |
400 nm à 800 nm. |
|
Ondes et signaux Comment reconnaît-on une lentille mince convergente ? Fiche 1 |
Son centre est épais et ses bords sont fins. |
|
Ondes et signaux Donner les points caractéristiques d’une lentille convergente. Fiche 2 |
Le centre optique O, le foyer objet F et le foyer image F’. |
|
Ondes et signaux Définir la distance focale. Fiche 3 |
Distance entre le centre optique O et le foyer image F’. |
|
Ondes et signaux Comment un rayon passant par le centre optique O émerge-t-il d’une lentille convergente ? Fiche 4 |
Sans être dévié. |
|
Ondes et signaux Comment un rayon parallèle à l’axe optique émerge-t-il d’une lentille convergente ? Fiche 5 |
En passant par le foyer image F’. |
|
Ondes et signaux Comment un rayon passant par le foyer objet F émerge-t-il d’une lentille convergente ? Fiche 6 |
Parallèle à l’axe optique. |
|
Ondes et signaux Définir le grandissement d’une lentille mince. Fiche 7 |
Rapport entre la taille de l’image et celle de l’objet. |
|
Ondes et signaux Qu’est-ce qu’une image réelle ? Fiche 8 |
Une image observable sur un écran. |
|
Ondes et signaux Sur quelle partie de l’œil l’image d’un objet se forme-t-elle ? Fiche 9 |
Sur la rétine. |
|
Ondes et signaux Dans le modèle de l’œil réduit, quelle partie de l’œil modélise la lentille mince convergente ? Fiche 10 |
Le cristallin. |
|
Ondes et signaux Comment branche-t-on un ampèremètre dans un circuit ? Fiche 1 |
En série. |
|
Ondes et signaux Donner l’unité de l’intensité I du courant. Fiche 2 |
L’ampère, de symbole A. |
|
Ondes et signaux Énoncer la loi des nœuds. Fiche 3 |
La somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent. |
|
Ondes et signaux Comment branche-t-on un voltmètre dans un circuit ? Fiche 4 |
En dérivation. |
|
Ondes et signaux Donner l’unité de la tension électrique U. Fiche 5 |
Le volt, de symbole V. |
|
Ondes et signaux Énoncer la loi des mailles. Fiche 6 |
Dans une maille (boucle fermée) orientée, la somme des tensions affectées de leur signe est nulle. |
|
Ondes et signaux Donner l’unité de la résistance d’un dipôle ohmique. Fiche 7 |
L’ohm, de symbole Ω. |
|
Ondes et signaux Quelle est l’allure de la caractéristique tension-courant d’un dipôle ohmique de résistance R ? Fiche 8 |
C’est une droite passant par l’origine de coefficient directeur égal à la résistance R. |
|
Ondes et signaux Nommer la loi permettant de relier la tension U aux bornes d’un dipôle ohmique et l’intensité I du courant le traversant. Fiche 9 |
La loi d’Ohm. |
|
Ondes et signaux Donner la relation entre la tension U aux bornes d’un dipôle ohmique et l’intensité I du courant le traversant. Préciser les unités. Fiche 10 |
U = R × I avec U la tension en V I l’intensité du courant en A R la résistance en Ω |
|
Ondes et signaux Définir le point de fonctionnement d’un circuit série comportant un dipôle récepteur et un générateur. Fiche 11 |
Point d’intersection des caractéristiques du générateur et du dipôle récepteur branchés en série. |